Fermez les yeux et visualisez le potager dont vous rêvez. Ça y est : vous l’avez. Problème : vous bloquez à l’étape des semis ! C’est normal, entre le choix des graines, de la température et de la technique pour semer, il y a de quoi s’y perdre. Pas de panique, dans cet article, nous vous donnons toutes les clés pour enfin réussir à faire germer vos semis, et ce, même si vous débutez. Bonne lecture !
1. Bien planifier ses semis
On vous voit : vous êtes tout excité(e) à l’idée de lancer votre premier potager. Attention, on ne sème pas n’importe comment : les dates de semis varient selon les végétaux. Cultures d’hiver, d’été, semis de printemps, d’automne, dans la nature il y en a pour tous les goûts !
Quelques exemples :
- Tomates : de février à avril
- Capucines et cosmos : avril-mai
- Le basilic : dès le mois de mars
- Navets, laitues, épinards, fèves : à l’automne
En fait, chaque variété possède un calendrier interne. Conclusion : pour vous y retrouver, vous aurez vous aussi besoin d’un calendrier ! Vous devez planifier.
Première étape, notez dans un carnet (ou dans votre application de jardinage préférée) les périodes optimales de chaque variété. Alors oui, l’exercice n’est pas des plus excitants, on en convient. Mais, faites nous confiance, c’est toujours mieux que de ne rien récolter de ce qu’on a semé.
Autre point à considérer : le climat. Vous habitez dans le sud ? Il y a de bonnes chances que les conditions locales vous permettent de semer un peu plus tôt !
2. Utiliser des semences de qualité
Toutes les semences ne se valent pas. Maintenant que vous le savez, comment les choisir ? D’abord, on vous conseille de privilégier le bio (découvrez notre article : qu’est-ce qu’une graine bio ?). Les graines sont cultivées dans le respect des principes de l’agriculture biologique. Elles n’auront pas reçu de traitements chimiques et sont généralement plus résistantes. Ensuite, optez pour des semences reproductibles (qu’est-ce qu’une graine reproductible ?). Ainsi vous préservez la diversité génétique du végétal et vous pourrez même récolter vos semences pour les cultures de la saison suivante !
Dernier conseil : faites attention aux conditions de stockage de vos semences ! Conservez vos graines au sec, à l’abri de la lumière et de l’humidité. En cas de doute sur leur état, un simple test de germination suffira. Placez quelques graines sur du papier absorbant humide, gardez-les au chaud et observez. Si elles germent, tout va bien ! Sinon, payez-leur un aller simple direction le compost.

2. Semer un peu plus de graines qu’on souhaite de plants
Laissez-nous vous introduire à un concept tout à fait regrettable : le taux de germination. Prenons l’exemple des tomates : elles ont un taux d’environ 90%. Cela signifie que sur 10 graines, 9 ont toutes leurs chances, mais que l’une d’entre elles risque fortement de ne jamais germer. Oui, la nature est cruelle.
Comment réagir face à tant de violence ? Anticipez. Vous voulez 10 plants de tomates ? Semez-en 11. Finalement, le seul risque que vous encourez en plantant davantage, c’est de vous retrouver avec un peu plus que prévu. Est-ce si grave ? Ce n’est pas l’avis de vos voisins, qui seront ravis de récupérer les excédents. Et sait-on jamais : peut-être qu’un don de concombre débouchera sur une belle amitié ?
4. Faire ses semis au bon endroit
Vous choisissez votre appartement sur un coup de tête ? Non, vous avez des préférences ! Eh bien, c’est exactement pareil pour vos semis. Bon, il y a peu d’être quelques différences, mais vous avez l’idée. Vous devez sélectionner un emplacement en fonction des variétés. Certaines graines s’épanouissent sous la chaleur, tandis que d’autres prospèrent au frais.
Globalement, vous avez trois options :
- En extérieur : Parfait pour les légumes rustiques comme les radis, les pois ou les épinards. Ils craignent peu le froid.
- En intérieur : Idéal pour les petits frileux comme les tomates, les poivrons ou les aubergines.
- Sous châssis : Sa protection transparente (vitres, plexiglas, voiles) créé un micro climat que vos jeunes pousses adoreront. Particulièrement adapté pour les salades, les carottes ou les choux.
5. Utiliser la bonne technique de semis
Dites-nous comment vous semez, nous vous dirons qui vous êtes. Bon, peut-être pas. Toutefois, il existe effectivement plusieurs techniques pour semer.
À la volée : Simple, rapide. On disperse les graines en les lançant à la main. Forcément, on est moins précis, mais c’est diablement pratique pour les grandes parcelles. Pour ne pas les citer, le blé et l’orge s’y prêtent très bien, tout comme le coquelicot.
En ligne : On trace un sillon, on sème dedans, on recouvre. Si vous aimez quand c’est organisé, vous allez adorer. En plus, le désherbage et l’entretien seront d’autant plus simple. On utilise notamment cette technique pour les carottes et les poireaux : on optimise l’espace tout en leur offrant toutes les chances de bien se développer.
En poquet : On dépose quelques graines dans un même trou. Vous limitez les pertes et optimisez l’espace. Très utile pour les petits jardins. On se sert généralement de cette méthode pour les grosses graines comme les haricots, petits pois, maïs, etc..

6. Faire attention à la profondeur des semis
La règle est simple : plus la graine est grosse, plus elle doit être semée profondément dans la terre.
Les grosses graines (haricots, fèves) aiment être bien enterrées, car elles ont la force de percer la surface. À l’inverse, les fines graines (carottes, laitues) se contentent d’une légère couche de terre. Si par malheur, vous les semiez trop profondes, vous les condamneriez à ne jamais connaître la lumière.
Pour vous donner un ordre d’idée, on dit habituellement que la profondeur des semis des graines est égale à leur taille. Environ bien sûr, rangez donc ce mètre ruban !
7. Utilisez un terreau spécial semis
Il y a le bon terreau et le mauvais terreau. Enfin, il y a surtout des terreaux adaptés pour chaque usage. Rendez-vous dans la jardinerie la plus proche pour y débusquer un terreau spécial semi !
Et, si vous n’aimez pas les vendeurs de jardineries acheter des produits tout faits, pourquoi ne pas fabriquer votre propre terreau ? Vous découvrirez dans cet article plusieurs recettes maison : compost, gazon, feuilles… C’est écologique, économique, et simple. Dur de trouver un slogan plus vendeur.
8. Utilisez des étiquettes de jardinage
Les jeunes pousses ont la fâcheuse habitude de toutes se ressembler. Ne leur dites surtout pas, vous risqueriez de les vexer. Mais c’est une source de problèmes pour de nombreux jardiniers en herbe. Croyez-nous, il n’y a rien de pire que d’avoir chouchouté un pied de basilic pendant des semaines, pour enfin découvrir que c’est une ortie. Même après plusieurs douches, le goût amer de la trahison persiste.
Pour éviter ce genre de désagrément, utilisez des étiquettes de jardinage. Petite publicité bien placée : les nôtres sont en bois issu de forêts gérées durablement.
9. Placez dans un endroit au chaud et conservez la terre humide
Chaleur et humidité : c’est le duo gagnant d’une germination réussie. Où d’un bel été en Colombie. On s’égare, revenons à vos semis : trouvez-leur un coin douillet, comme un rebord de fenêtre bien ensoleillé ou une mini-serre. Ensuite, vous avez une mission : garder la terre humide, mais sans jamais la noyer !
Attention, les températures de germination optimales varient fortement selon les variétés. Les semis de tomates se plairont entre 20 et 25°C, tandis que les haricots préfèreront osciller entre 15 et 18°C. Prenez le temps de vous renseigner selon ce que vous souhaitez semer !
10. Placez vos plants à la lumière une fois sortie de terre
Lumière, chaleur, eau : voilà tout ce dont vous avez besoin pour éviter que vos semis ne filent. De quoi parle–t-on ? C’est simple, on dit que les semis “filent” lorsque les tiges deviennent si longues et fines qu’elles fragilisent vos jeunes plants. C’est déjà trop tard ? Ne hurlez pas “ Pourquoi mes semis filent ?”, lisez plutôt notre article pour corriger le tir avec des gestes simples comme le surfaçage ou la transplantation.
Autrement, vous pouvez apprendre à fabriquer une mini-serre avec des vieux bocaux ou boîtes à chaussures. De cette façon, vos prochains semis ne fileront pas !

11. Repiquez au bon moment
Vos semis ont sorti leurs premières « vraies » feuilles (celles après les cotylédons) ? Les dernières gelées sont passées ? C’est le signal : il est temps de repiquer ! Ainsi, les racines pourront s’étendre et renforcer vos plants.
Pas de gestes brusques, un déménagement, c’est toujours stressant ! Détachez délicatement chaque plant, en gardant une motte de terre autour des racines. Plantez-les dans un pot plus grand ou en pleine terre.
Arrosez généreusement, et placez vos jeunes plants à la lumière. Félicitations, vous venez officiellement de repiquer vos premiers plants.
Attention cependant : toutes les cultures ne se prêtent pas au repiquage ! Certaines plantes sont particulièrement sensibles au stress du transplant, ou à la manipulation de leurs racines. Dans ce cas-là, vous devrez alors les semer directement en pleine terre.
12. Protéger les semis des ravageurs
Là où vous voyez un jardin en plein développement, les escargots et les limaces contemplent un buffet à volonté. Et vous êtes leur cuisinier personnel ! Si ce plan de carrière vous déplaît, il va falloir les éloigner.
Pour cela, il existe bon nombre de méthodes naturelles : paillez le sol, placez des barrières comme des coquilles d’œufs concassées, ou utilisez des pièges à bière. Si vous voulez être paré à toute éventualité, consultez nos guides de survie pour limaces ou pour escargots.
Bon, avec tous ces conseils, vous avez d’excellentes bases pour réussir vos premiers semis. Bien sûr, vous pourriez continuer à vous renseigner… mais, vous pouvez tout aussi bien vous lancer dès maintenant ! Rien ne vaut l’expérience : testez, expérimentez, et surtout, amusez-vous.
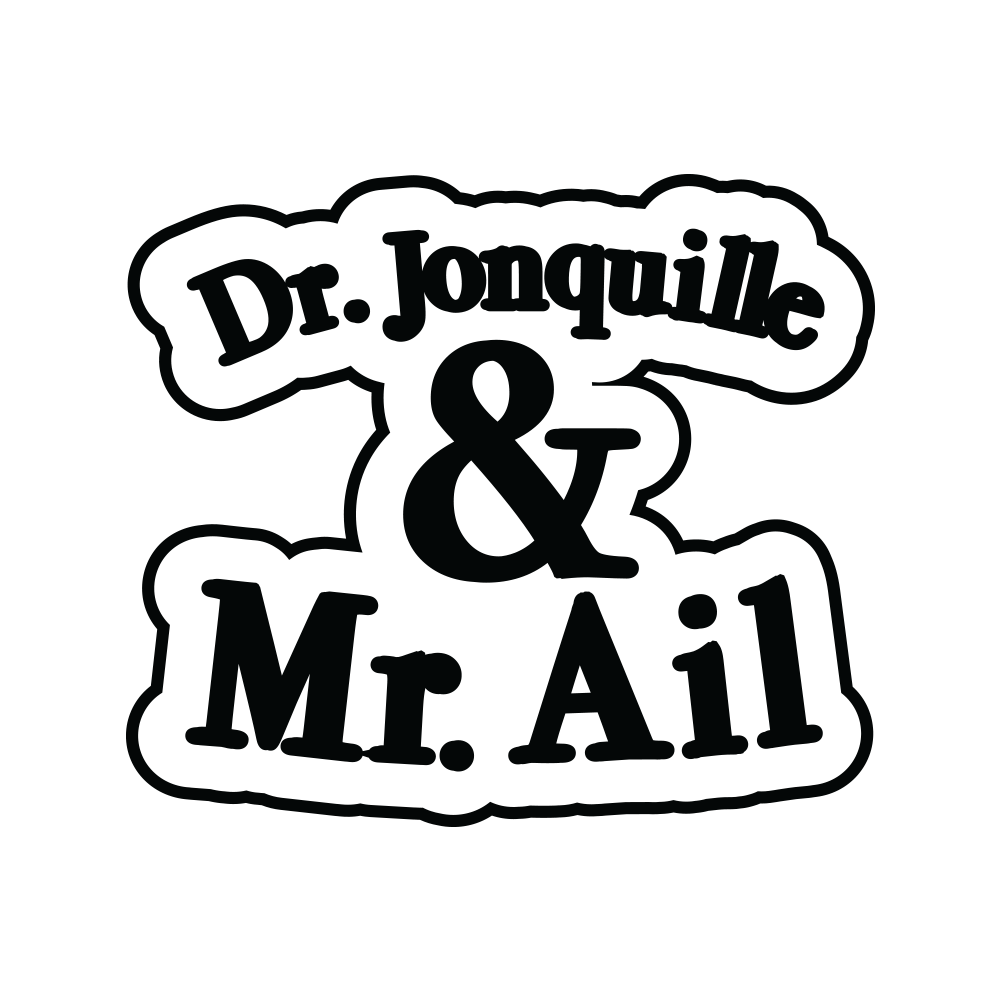



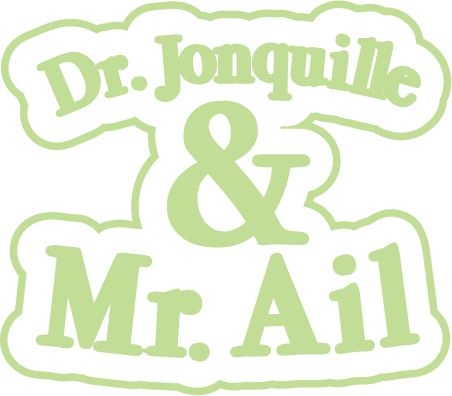

Michel Molter
Jardinez-vous avec le cycle lunaire lune ?
Avez-vous un article à ce sujet ?
Dr. Jonquille & Mr. Ail
Bonjour Michel,
Oui nous nous sommes penchés sur le sujet ! Voici le lien de notre article sur le jardinage avec la lune : https://djma.fr/blog/jardipedia/jardiner-avec-la-lune.
Bonne lecture !